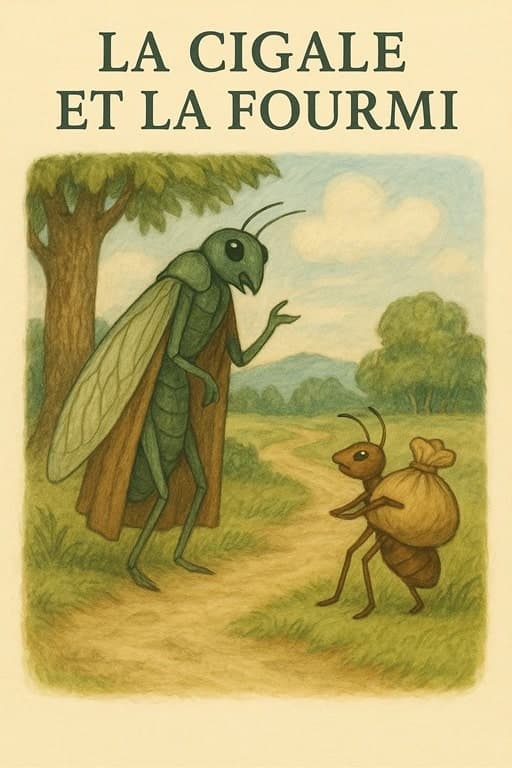
Présentation :
« La Cigale et la Fourmi » est la première fable du premier livre de Jean de La Fontaine, publiée en 1668. Elle met en scène deux animaux emblématiques aux comportements opposés : la Cigale insouciante et chantante durant l’été, et la Fourmi prévoyante, qui travaille pour préparer l’hiver. Cette fable illustre les vertus du travail et de la prévoyance, mais aussi les limites de la solidarité.
– Jean de La Fontaine (1668)
La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se retrouva bien dépourvue
Quand l’hiver fut venu :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla demander de la nourriture
À sa voisine la Fourmi,
La priant de lui prêter
Quelques grains pour survivre
Jusqu’au retour des beaux jours :
« Je vous rembourserai, lui dit-elle,
Avant le mois d’août, c’est juré,
Avec les intérêts. »
La Fourmi n’aime pas prêter :
C’est son moindre défaut.
« Que faisiez-vous durant l’été ?
Lui dit-elle.
— Je chantais jour et nuit,
Si cela ne vous déplaît.
— Vous chantiez ? J’en suis ravie.
Eh bien, dansez maintenant. »
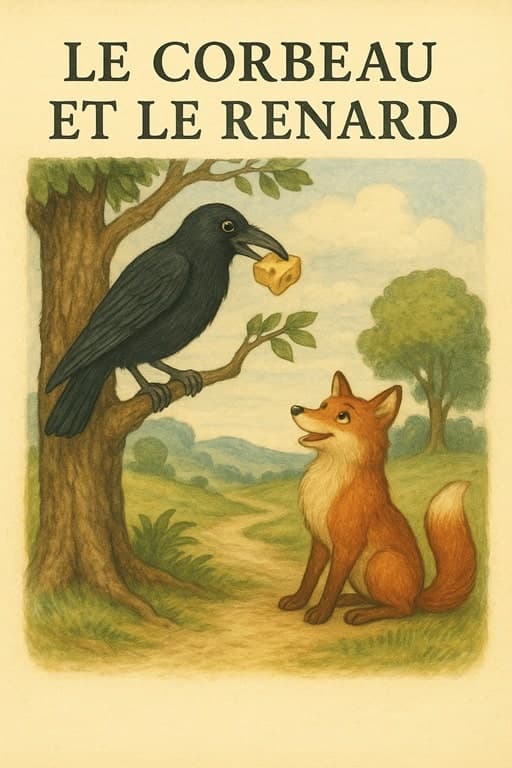
Présentation :
« Le Corbeau et le Renard » est l’une des fables les plus célèbres de Jean de La Fontaine, publiée dans le premier livre de ses Fables en 1668. Cette fable illustre l’art de la flatterie et ses dangers, à travers une scène animalière classique. Le Renard flatte le Corbeau pour lui faire lâcher un fromage. La morale, pleine d’ironie, met en garde contre ceux qui savent manipuler par les mots.
– Jean de La Fontaine (1668)
Un corbeau, perché sur un arbre,
Tenait un fromage dans son bec.
Un renard, attiré par l’odeur,
Lui parla à peu près ainsi :
« Bonjour, Monsieur le Corbeau !
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Si votre chant est aussi beau que vos plumes,
Vous êtes le roi des habitants de ces bois. »
Le Corbeau, flatté, n’y tient plus,
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre grand le bec… et fait tomber le fromage.
Le Renard s’en empare et dit :
« Mon cher Monsieur, sachez que
Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, vous ne trouvez pas ? »
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura (mais un peu tard) qu’on ne l’y prendrait plus.
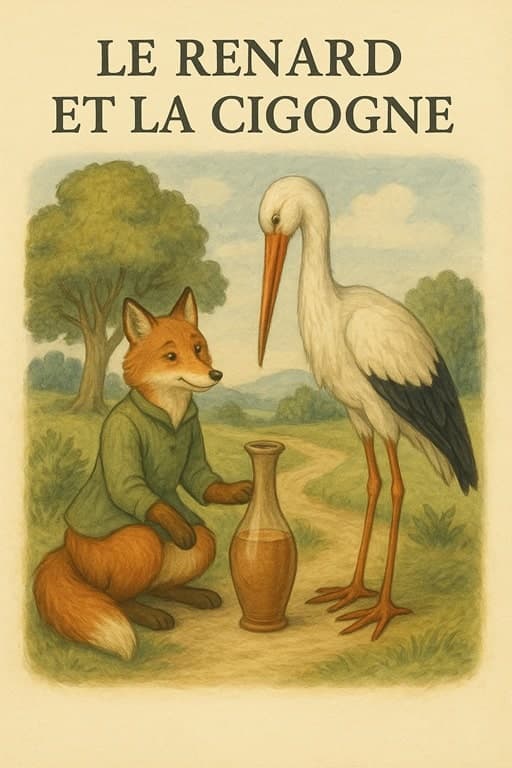
Présentation :
« Le Renard et la Cigogne » est une fable de Jean de La Fontaine, publiée dans le premier recueil de ses Fables en 1668. Elle met en scène une ruse du Renard qui invite la Cigogne à un repas inadapté à son bec. Mais la Cigogne, loin d’être dupe, lui rend la pareille. Cette fable illustre le principe de réciprocité et rappelle que ceux qui jouent des tours doivent s’attendre à les recevoir.
– Jean de La Fontaine (1668)
Un jour, le Renard, voulant briller par sa générosité,
Invita la Cigogne à dîner.
Le repas était très simple : un potage clair,
Servi sur une assiette plate.
La Cigogne, avec son long bec,
N’en put attraper une goutte,
Tandis que le Renard lécha le tout en un instant.
Quelques jours plus tard, pour se venger,
La Cigogne invita le Renard.
Il accepta sans se méfier.
Le jour venu, il arriva chez son hôtesse
Et la remercia de son accueil.
On lui servit une viande découpée en petits morceaux,
Mais dans un vase haut et étroit.
La Cigogne, avec son bec, mangea sans problème,
Mais le Renard ne put rien attraper avec son museau.
Il repartit affamé, humilié,
La queue basse, les oreilles baissées.
Cette fable s’adresse aux trompeurs :
Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas subir.
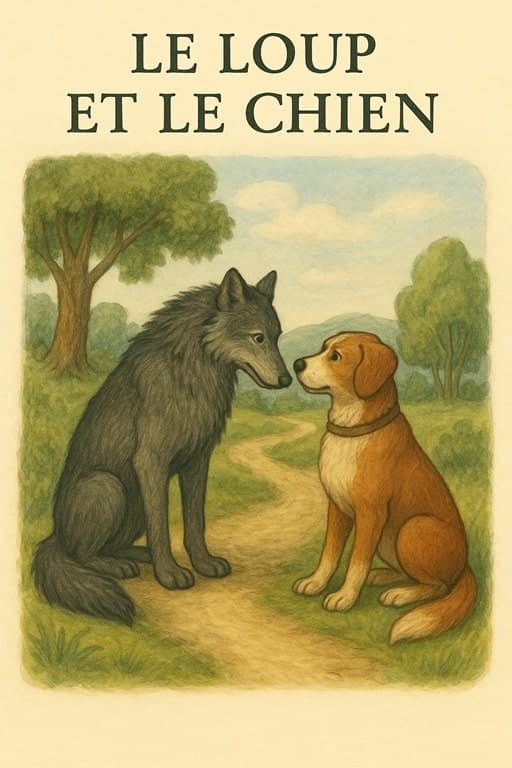
Présentation :
« Le Loup et le Chien » est une fable de Jean de La Fontaine, publiée dans le premier livre de ses Fables en 1668. Elle met en opposition deux modes de vie : celui du Loup, libre mais souvent affamé, et celui du Chien, bien nourri mais enchaîné par la servitude. À travers ce dialogue entre deux animaux, La Fontaine invite à réfléchir sur la liberté, la sécurité et les compromis que l’on accepte parfois pour le confort matériel.
– Jean de La Fontaine (1668)
Un Loup, très maigre et affamé,
car les chiens gardaient bien les troupeaux,
rencontra un gros Chien fort, bien nourri,
et bien soigné, qui s’était égaré.
Le Loup aurait bien voulu l’attaquer,
mais le Chien était robuste et pouvait se défendre.
Alors le Loup l’aborda poliment,
et le complimenta sur sa belle allure.
Le Chien lui dit :
« Tu pourrais être comme moi si tu quittais les bois.
Là-bas, vous vivez dans la misère,
et vous mourez de faim.
Viens avec moi : tu auras une vie bien meilleure. »
Le Loup demanda :
« Que devrai-je faire ? »
Le Chien répondit :
« Pas grand-chose.
Tu devras chasser les mendiants,
flatter les gens de la maison,
et obéir au maître.
En échange, tu auras plein de restes à manger
et beaucoup de caresses. »
Le Loup, ému, imaginait déjà cette vie confortable.
Mais en marchant, il vit une marque au cou du Chien.
« Qu’est-ce que c’est ? » demanda-t-il.
« Rien, » répondit le Chien.
« Juste la trace du collier auquel je suis attaché. »
Le Loup, surpris, dit :
« Attaché ? Tu ne peux donc pas aller où tu veux ? »
— « Pas toujours, mais ce n’est pas grave. »
— « Oh si, c’est très grave ! » dit le Loup.
« Je préfère ma faim et ma liberté
à ta nourriture et ta chaîne. »
Et sur ces mots, le Loup s’enfuit, et on ne l’a plus revu.
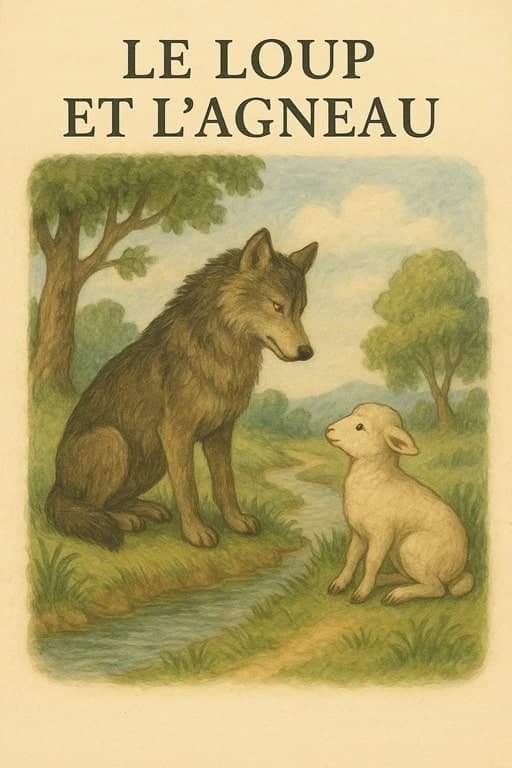
Présentation :
« Le Loup et l’Agneau » est l’une des fables les plus célèbres de Jean de La Fontaine, publiée en 1668 dans le premier livre de ses Fables. Elle dénonce l’arbitraire du pouvoir et la loi du plus fort, à travers une scène où un Loup cherche un prétexte pour dévorer un Agneau innocent. Malgré les tentatives de justification de l’Agneau, le Loup reste sourd à toute logique, montrant que, face à la force brute, la raison ne pèse rien.
– Jean de La Fontaine (1668)
La raison du plus fort est toujours la meilleure.
En voici un exemple.
Un Agneau buvait dans un ruisseau limpide.
Un Loup, affamé, arriva par hasard dans le coin.
— Comment oses-tu troubler mon eau ? lui cria-t-il, furieux.
Tu vas être puni pour ton insolence !
— Sire, répondit l’Agneau, que Votre Majesté
ne se fâche pas :
je bois bien en aval, loin de vous,
et je ne peux donc en aucun cas troubler votre boisson.
— Tu la troubles ! répliqua le Loup.
Et je sais que tu as mal parlé de moi l’an dernier.
— Comment aurais-je pu ? dit l’Agneau.
Je n’étais même pas né, je tète encore ma mère.
— Si ce n’est pas toi, c’est ton frère.
— Je n’en ai pas.
— Alors c’est quelqu’un de ta famille !
Vous, vos bergers, vos chiens, vous me persécutez !
Je dois me venger.
Et là-dessus, dans un coin de forêt,
Le Loup l’emporta… et le mangea,
Sans autre forme de procès.
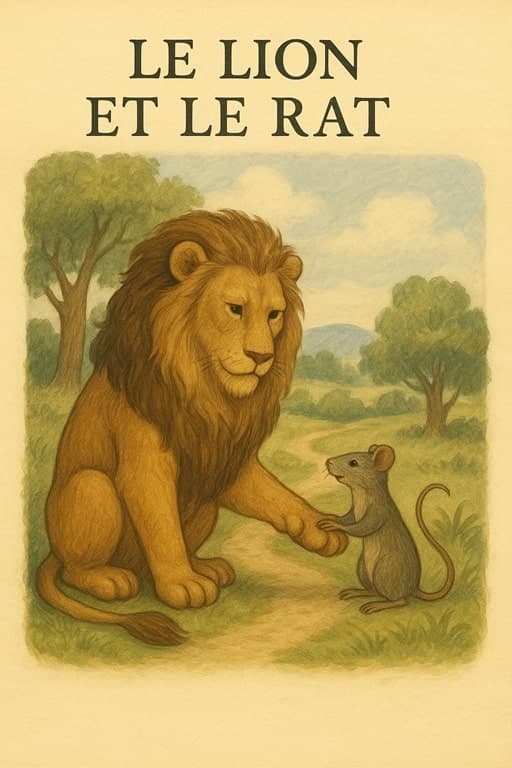
Présentation :
« Le Lion et le Rat » est une fable de Jean de La Fontaine, publiée en 1668 dans le premier livre de ses Fables. Elle enseigne que nul n’est trop petit pour rendre service, et que la reconnaissance peut venir de ceux qu’on croit faibles ou insignifiants. Dans cette histoire, un Lion épargne un Rat, et ce dernier lui sauvera la vie plus tard. La morale met en lumière la force de l’entraide et la valeur de chaque être, quels que soient sa taille ou son statut.
– Jean de La Fontaine (1668)
Il faut, autant qu’on peut, rendre service à tout le monde :
On a souvent besoin de plus petit que soi.
Voici un exemple :
Un Lion s’était retiré dans sa tanière pour se reposer.
Un Rat en sortit de terre et courut sur le Lion,
ce qui le réveilla.
Aussitôt, le Lion attrape le Rat
et s’apprête à le dévorer.
Le Rat le supplie :
« Épargne-moi ! Un jour, je te rendrai service. »
Le Lion, amusé, le relâche.
Quelque temps plus tard,
le Lion tombe dans un filet.
Ses rugissements ne l’aident pas à se libérer.
Le Rat accourt, ronge les cordes
et libère le Lion.
La patience et la persévérance
sont parfois plus efficaces que la force ou la colère.
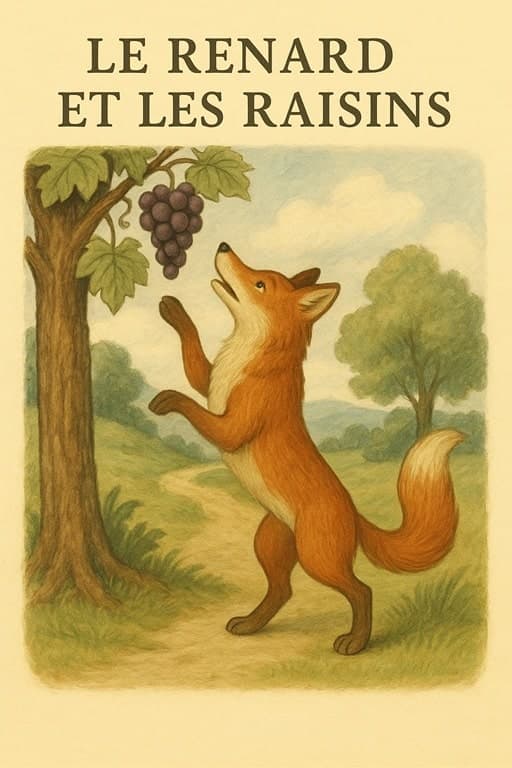
Présentation :
« Le Renard et les Raisins » est une courte fable publiée par Jean de La Fontaine en 1668. Elle met en scène un renard qui, ne parvenant pas à attraper des raisins trop hauts pour lui, prétend qu’ils ne sont pas mûrs afin de dissimuler son échec. La morale de cette fable illustre un comportement très humain : la rationalisation de nos échecs par le mépris de ce que l’on ne peut obtenir. L’expression « Ils sont trop verts » est d’ailleurs devenue proverbiale.
– Jean de La Fontaine (1668)
Un certain Renard gascon (ou normand, selon certains),
Affamé et presque mourant, aperçut en haut d’une treille
Des raisins qui semblaient mûrs
Et bien rouges.
Il aurait bien aimé s’en faire un bon repas.
Mais comme il ne pouvait pas les atteindre :
« Ils sont trop verts, dit-il, bons pour des idiots. »
N’a-t-il pas mieux fait que de se plaindre ?
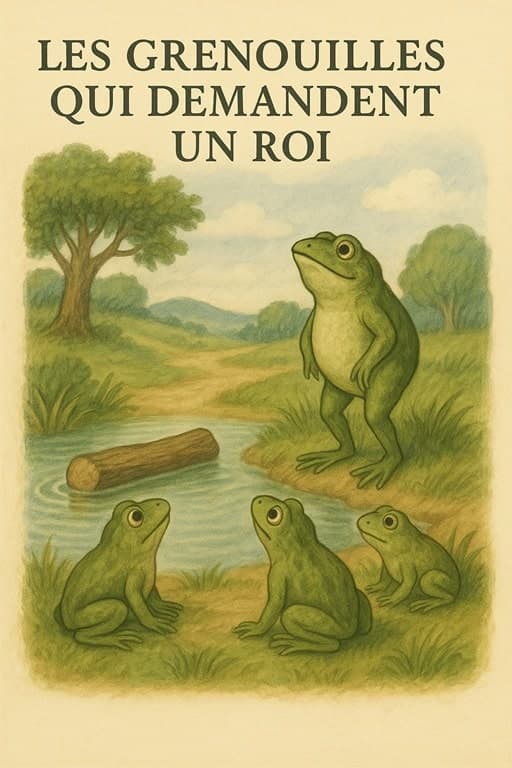
Présentation :
« Les Grenouilles qui demandent un Roi » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1668 dans le premier livre de ses Fables. Elle critique les peuples qui, las de la liberté ou du désordre, réclament un pouvoir fort, sans réfléchir aux conséquences. Les Grenouilles, lassées de leur indépendance, supplient Jupiter de leur envoyer un roi. Elles déchanteront rapidement… Cette fable illustre brillamment la satire politique de La Fontaine et reste d’une actualité frappante.
– Jean de La Fontaine (1668)
Les Grenouilles, fatiguées De vivre sans roi ni chef, Se mirent à se plaindre Et à crier si fort Que Jupiter, excédé, Décida de leur en envoyer un. Il leur envoya un roi : un simple morceau de bois. Le "roi" tomba dans l’étang avec fracas. Les Grenouilles, d’abord terrifiées, N’osaient pas s’en approcher. Mais comme il restait immobile, Elles finirent par le considérer comme un lâche. Alors elles se remirent à crier Pour obtenir un roi plus actif. Jupiter leur envoya une grue, Un prédateur qui les attrapait et les mangeait. Elles crièrent à nouveau, affolées, Et Jupiter leur répondit : « Vous vouliez un roi ? Le voilà. Retenez ceci : ne changez pas un état libre Contre un pouvoir oppresseur. Apprenez à vous contenter D’une liberté simple, même imparfaite. »
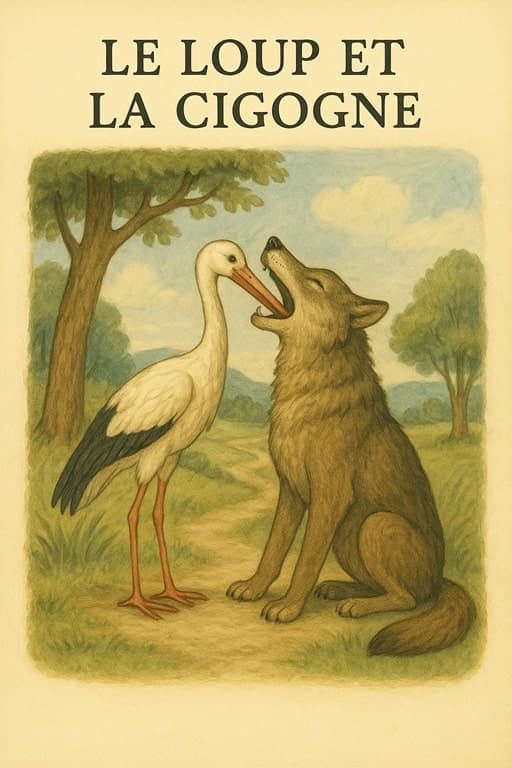
Présentation :
« Le Loup et la Cigogne » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1668. Elle dénonce l’ingratitude à travers l’histoire d’une Cigogne qui aide un Loup en détresse, mais ne reçoit aucune récompense en retour. La morale de cette fable est limpide : certains puissants, même secourus, restent égoïstes et ingrats. Elle met en garde contre l’attente de reconnaissance de la part des plus forts ou des injustes.
– Jean de La Fontaine (1668)
Les Loups mangent avec avidité. L’un d’eux, un jour de festin, S’étouffa presque à force de se presser. Un os resta coincé au fond de sa gorge. Par chance, une Cigogne passait par là. Le Loup, incapable de parler, lui fit signe. Elle accourut et, grâce à son long bec, Parvint à retirer l’os. Une fois rétabli, le Loup lui dit : « Je te récompenserai pour ton aide. » Mais au lieu de lui donner quoi que ce soit, Il ajouta : « Considère-toi déjà chanceuse D’avoir retiré ta tête de ma gueule sans y rester. Je ne suis pas du genre à remercier. »
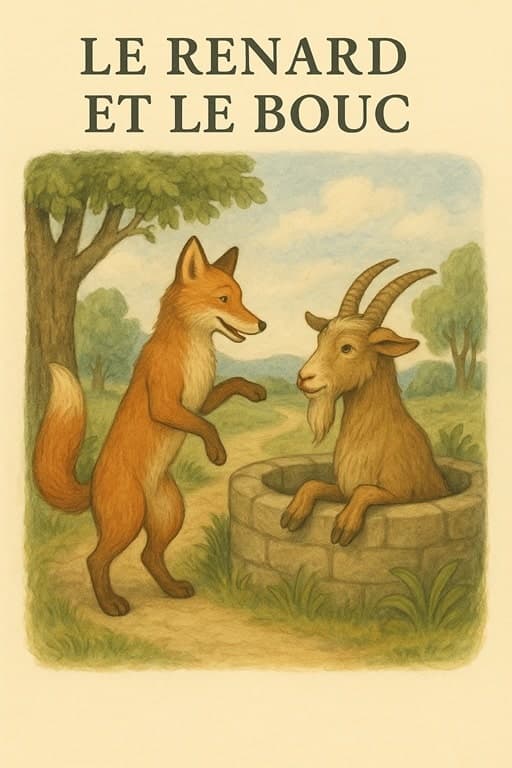
Présentation :
« Le Renard et le Bouc » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1668 dans le premier recueil de ses Fables. Elle illustre la ruse et la naïveté : un Renard utilise la crédulité d’un Bouc pour se sortir d’un puits, et le laisse derrière lui. La morale est claire : il ne faut pas se fier aux apparences ni prendre conseil de quelqu’un en difficulté. Une leçon sur la prudence, la réflexion et le bon sens.
– Jean de La Fontaine (1668)
Le Renard marchait en compagnie Avec un Bouc à l’air bien poilu. Le Bouc, un peu naïf, ne réfléchissait pas beaucoup, Tandis que le Renard était très rusé. Tous deux eurent soif et descendirent dans un puits. Là, ils burent à volonté. Mais une fois désaltérés, il fallait remonter… Le Bouc se demanda comment faire. Le Renard lui dit : « Mon ami, si tu m’écoutes, on va s’en sortir. Appuie tes pattes contre le mur, Tends ta barbe, baisse un peu la tête. Je grimperai sur ton dos, puis sur ta tête, Et de là, je sortirai du puits. Ensuite, je t’aiderai à en sortir en te tirant par la barbe. » — « Par ma barbe ! » dit le Bouc, « vous êtes plein de ressources ! » Le Renard sortit du puits… et laissa le Bouc en bas. Puis il lui lança ce conseil : « Si tu avais autant de bon sens que moi, Tu ne serais pas descendu sans penser à comment remonter. »