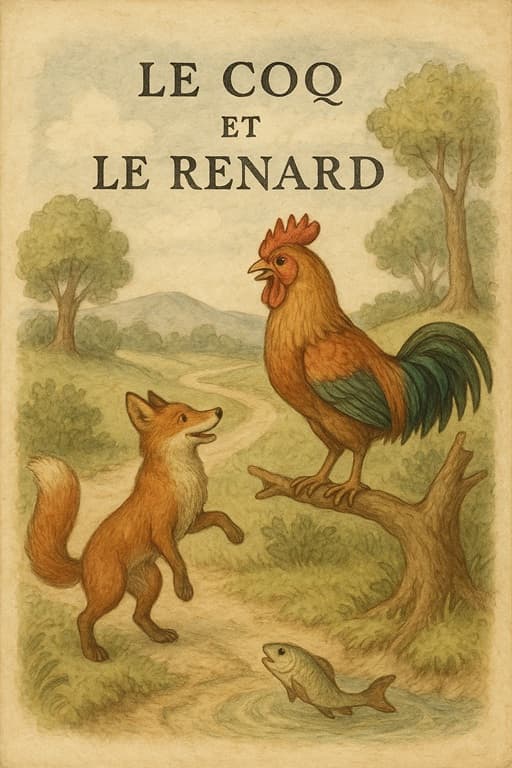
Présentation :
« Le Coq et le Renard » est une fable de Jean de La Fontaine parue dans le Livre II de ses Fables en 1678. Elle met en scène un Renard rusé qui tente de tromper un Coq pour le manger. Mais le Coq, méfiant et malin, retourne la situation. La fable illustre l’importance de la prudence et de la répartie face à la flatterie et à la ruse. Elle se termine sur une note de sagesse : la méfiance peut parfois sauver la vie.
– Jean de La Fontaine (1678)
Un vieux Coq, rusé, était perché sur une branche. Un Renard s’approche et lui dit d’une voix douce : « Mon frère, la guerre est finie, c’est la paix générale ! Je viens te l’annoncer. Descends que je t’embrasse. » Le Renard poursuit : « Je dois prévenir aussi tes voisins. Je me dépêche, Je veux qu’on voie que cette paix est sincère. Si les chiens n’étaient pas dans les environs, Je te montrerais mieux encore combien je suis amical. » Le Coq, malin, lui répond : « Justement, j’allais appeler les chiens pour fêter la paix ! Ils arrivent tout de suite. » Le Renard, pris de panique, s’enfuit aussitôt. **Morale :** Les trompeurs fuient quand ils sont pris à leur propre jeu. Un peu de prudence peut déjouer la ruse.
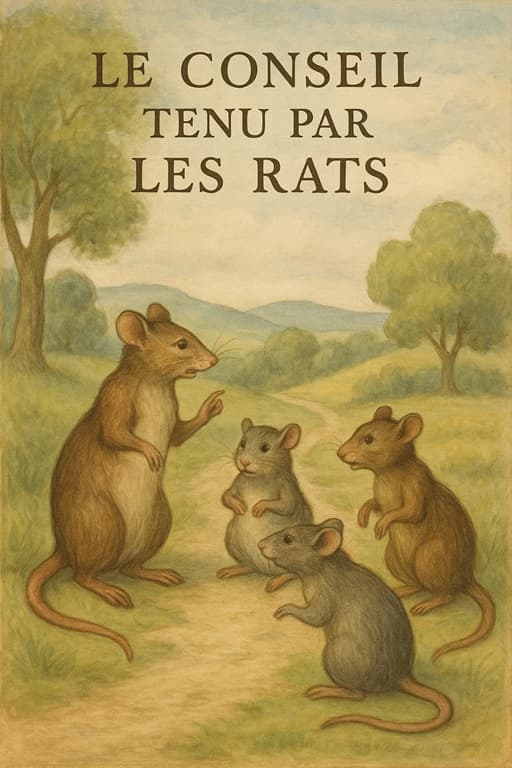
Présentation :
« Le Conseil tenu par les Rats » est une célèbre fable de Jean de La Fontaine, publiée en 1668 dans le Livre II de ses Fables. Elle raconte comment une communauté de rats cherche à échapper à leur ennemi commun, le chat. Une brillante idée est proposée, mais personne n’ose la mettre en pratique. La fable illustre la différence entre **parler et agir**, et souligne combien il est facile de proposer des solutions… tant qu’on n’a pas à les appliquer soi-même.
– Jean de La Fontaine (1668)
Un chat nommé Rodilardus Avait tellement massacré de rats Qu’il n’en restait presque plus. Les survivants, terrifiés, restaient cachés Et ne mangeaient presque rien. Ce chat était vu non comme un chat, Mais comme un véritable démon. Un jour, pendant qu’il était parti faire la cour à une chatte, Les rats se réunirent pour tenir conseil. L’un d’eux, un peu naïf mais plein d’idées, Proposa d’attacher une clochette au cou du chat : « Ainsi, dit-il, quand il s’approchera, Nous entendrons le grelot et pourrons fuir à temps. » Tous trouvèrent l’idée excellente. Mais… qui allait attacher le grelot ? Un dit : « Pas moi, je ne suis pas fou. » Un autre : « Moi non plus, sauf si on m’accompagne. » Et pendant qu’ils débattaient, Le chat revint sans bruit… Et mit fin à leur réunion. **Morale :** Il est facile de donner des idées, Mais beaucoup plus difficile de les mettre en œuvre.
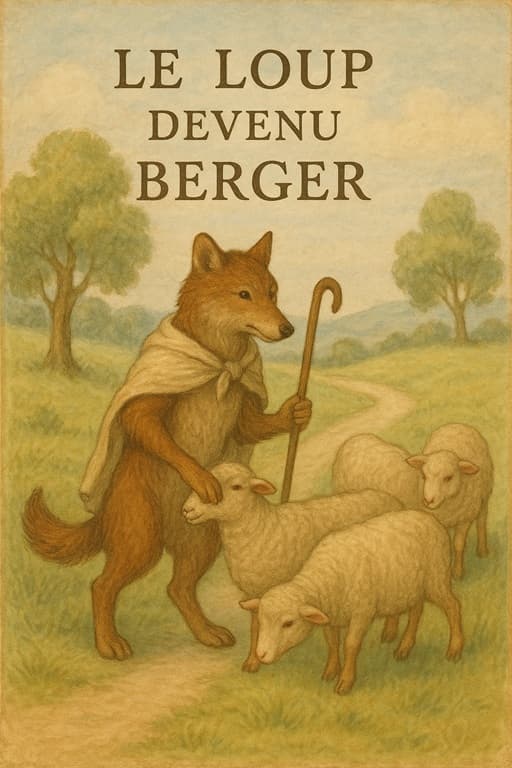
Présentation :
« Le Loup devenu Berger » est une fable de Jean de La Fontaine publiée en 1678 dans le Livre III de ses Fables. Elle raconte l’histoire d’un loup affamé qui se déguise en berger pour mieux tromper les moutons. La fable illustre la méfiance à avoir envers les apparences et ceux qui déguisent leurs intentions réelles. C’est une dénonciation de l’hypocrisie et de la manipulation, toujours très actuelle. La morale : il ne faut pas se fier à ceux qui changent soudainement de rôle… surtout quand ils y trouvent un intérêt.
– Jean de La Fontaine (1678)
Un Loup, qui ne parvenait plus à attraper des moutons, Décida d’utiliser la ruse. Il se déguisa en berger : Il se vêtit comme tel, prit une houlette, Et même une cornemuse pour faire illusion. Il aurait bien inscrit sur son chapeau : « Je suis Guillot, le berger de ce troupeau. » Ainsi déguisé, il menait tranquillement les moutons, Sans éveiller la moindre suspicion. Mais il voulait aller plus loin : Gagner la confiance du véritable berger. Il s’efforça d’être aimable, gentil, serviable. Le berger se laissa convaincre Et l’accueillit comme un vrai allié. Mais une nuit noire, Le Loup tua le berger, vola tout ce qu’il pouvait, Et s’enfuit. **Morale :** Se faire passer pour honnête ne suffit pas. Un imposteur finit toujours par trahir sa vraie nature, Et parfois, sa propre ruse se retourne contre lui.

Présentation :
« Le Lion et l’Âne chassant » est une courte fable de Jean de La Fontaine, publiée en 1678 dans le Livre VIII de ses Fables. Elle met en scène un Lion rusé qui utilise l’Âne pour effrayer les animaux et mieux les capturer. La fable souligne l’intelligence du Lion, qui reconnaît l’utilité d’un compagnon peu glorieux, mais efficace. La morale ? Il ne faut pas mépriser les moyens simples ou inattendus pour réussir, et même les faibles peuvent rendre service aux forts.
– Jean de La Fontaine (1678)
Un jour, le Roi Lion décida d’organiser une chasse. Il demanda à un Âne de l’accompagner. Les courtisans murmurèrent : « Pourquoi s’entourer d’un animal aussi ridicule ? » Mais le Lion insista. L’Âne poussa alors son célèbre braiment. Les animaux, terrifiés par ce bruit étrange, s’enfuirent dans tous les sens. Le Lion n’eut qu’à les attraper tranquillement. « Quelle belle chasse ! dit-il. Un si vilain cri m’a rendu un grand service. » **Morale :** Même les plus faibles peuvent être utiles. On peut tirer parti de tout… même d’un cri d’âne.
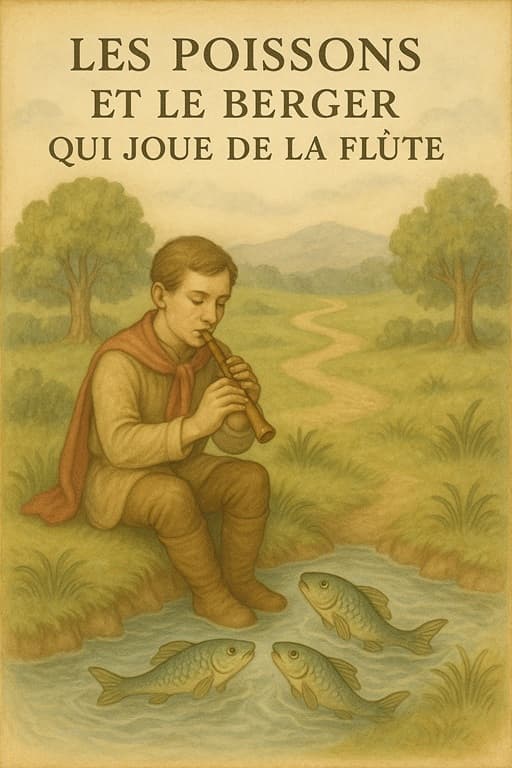
Présentation :
« Les Poissons et le Berger qui joue de la flûte » est une fable tardive de Jean de La Fontaine, publiée en 1694 dans le Livre XII. Elle illustre l’échec d’une approche douce quand elle est mal adaptée à la situation. Le berger tente de charmer les poissons en jouant de la flûte… mais ne réussit à les attraper qu’en utilisant la force. La morale : certains ne comprennent que la contrainte, et il faut savoir adapter ses méthodes à la réalité.
– Jean de La Fontaine (1694)
Un berger qui aimait jouer de la flûte Se mit un jour au bord d’une rivière, Espérant que sa musique Attirerait les poissons. Il joua doucement, longuement, En changeant de mélodie, Mais aucun poisson ne sortit. Agacé, il lança un filet dans l’eau Et attrapa plusieurs poissons d’un coup. En les voyant frétiller, il s’exclama : « Ah, maintenant vous venez ! Ce n’est donc pas la douceur qui vous touche, Mais la force ! » **Morale :** Certains ne répondent qu’à la contrainte, Et la douceur ne suffit pas toujours.
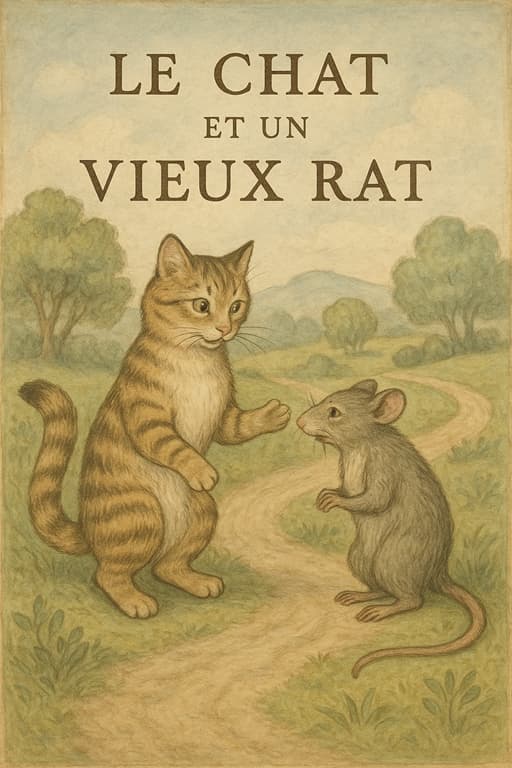
Présentation :
« Le Chat et un vieux Rat » est une fable de Jean de La Fontaine parue en 1678 dans le Livre III de ses Fables. Elle met en scène un chat rusé qui, ne pouvant attraper les rats comme avant, se déguise ou fait semblant d’être mort pour mieux les tromper. Mais un vieux rat expérimenté ne se laisse pas piéger. La fable valorise la prudence, l’expérience et la méfiance envers ceux qui changent soudainement de comportement pour tromper. Morale : la sagesse vient de l’expérience, et la méfiance est souvent le meilleur rempart contre la ruse.
– Jean de La Fontaine (1678)
Un Chat, nommé Raton, voulait attraper des Rats. Mais ceux-ci, devenus méfiants, se cachaient bien. Alors le Chat imagina un nouveau piège : Il fit semblant d’être mort. Il s’étendit au sol, la patte molle, l’œil fermé, L’air aussi inoffensif qu’un coussin. Les jeunes Rats, le croyant mort, sortirent un à un. Mais un vieux Rat, plus malin, resta sur ses gardes. Il observa, et dit : « Ce chat fait le mort, mais je le connais. C’est une ruse. Ce n’est pas la première fois. » Et il passa au large, évitant le piège. Le Chat bondit… mais c’était trop tard. **Morale :** On peut en tromper beaucoup, Mais pas ceux qui ont l’habitude des pièges.
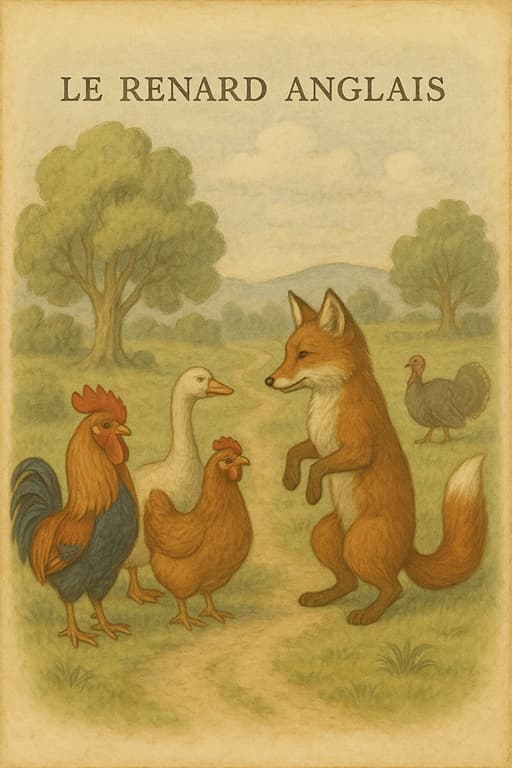
Présentation :
« Le Renard anglais » est l’avant-dernière fable du Livre XII de Jean de La Fontaine, publiée en 1694. Elle est dédiée à Madame Harvey, une dame anglaise installée en France. Cette fable met en scène un renard rusé, traqué par les chiens, qui simule sa pendaison pour leur échapper. Mais le stratagème, bien que brillant, échoue lorsqu’il est répété une fois de trop. La morale : les ruses, aussi fines soient-elles, perdent leur efficacité si on les utilise sans renouvellement.
– Jean de La Fontaine (1694)
Un Renard, poursuivi par une meute de chiens, Fuit à travers la campagne. Il finit par atteindre un gibet Où pendaient déjà plusieurs animaux. Pour leur échapper, il imagine un stratagème : Il se pend lui-même et fait le mort. Les chiens arrivent, s'arrêtent, Et le prennent pour un véritable cadavre. Ils repartent, convaincus. Plus tard, le Renard tente à nouveau la même ruse. Mais cette fois, les chiens ne sont pas dupes : « Ce renard sent la tromperie », disent-ils. Ils le jettent au sol, découvrent la supercherie Et le mettent à mort. Morale : On ne trompe pas deux fois avec la même ruse. Ce qui a marché une fois peut vous perdre la seconde.

Présentation :
« Le Lion et le Moucheron » est une fable du Livre II des Fables de Jean de La Fontaine, publiée en 1668. Elle met en scène un moucheron minuscule qui ose défier le roi des animaux, le Lion, et finit par l’emporter… avant de mourir bêtement, pris dans une toile d’araignée. La fable illustre que les plus petits peuvent triompher des plus puissants, mais aussi que la vanité ou l’imprudence peut ruiner la victoire. Morale : la force ne garantit pas la victoire, et l’orgueil peut être fatal, même aux plus rusés.
– Jean de La Fontaine (1668)
Le Lion et le Moucheron – Jean de La Fontaine
« Va-t’en, sale insecte ! » dit un jour le Lion au Moucheron. Mais le Moucheron, loin de fuir, lui déclare la guerre. Il fonce sur lui, le pique au nez, aux yeux, au front, Le Lion devient fou, il rugit, bondit, se frappe lui-même. Le petit insecte, rapide et agile, Repart, revient, attaque encore. Le Lion, impuissant à se défendre, finit par céder. Le Moucheron s’envole, tout fier de sa victoire. Mais peu après, dans son vol, Il se prend dans la toile d’une Araignée, Et y meurt, sans gloire, sans honneurs. **Morale :** Les plus petits peuvent vaincre les plus forts, Mais l’excès de confiance peut aussi tout perdre.
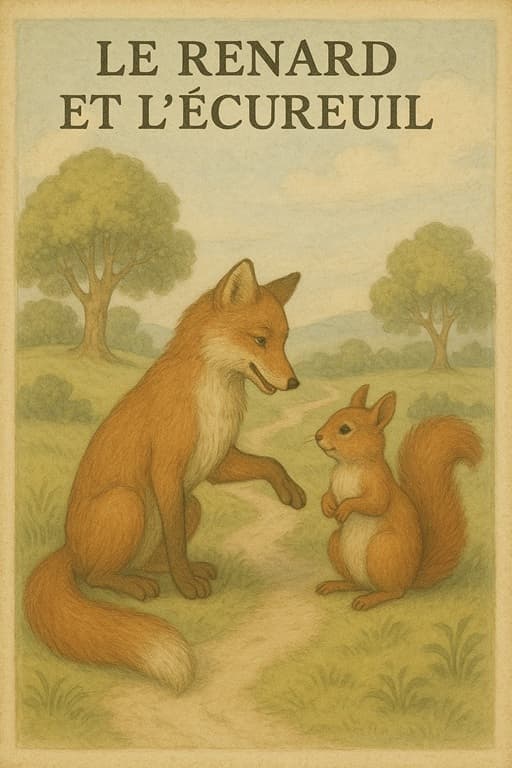
Présentation :
« Le Renard et l’Écureuil » est une fable attribuée à Jean de La Fontaine, publiée pour la première fois en 1861, bien après la mort de l’auteur. Elle met en scène un renard moqueur et un écureuil pris dans une tempête, illustrant la leçon de ne pas se moquer des malheurs d’autrui, car nul n’est à l’abri du destin. Morale : il ne faut jamais se moquer des misérables, car qui peut s’assurer d’être toujours heureux.
– Jean de La Fontaine (publié en 1861)
Il ne faut jamais se moquer des malheureux, Car nul ne peut garantir d'être toujours heureux. Le sage Ésope, dans ses fables, Nous en donne plusieurs exemples ; Mais une certaine histoire Nous en fournit une plus authentique. Un jour, le Renard se moquait de l'Écureuil Qu'il voyait assailli par une forte tempête : « Te voilà, disait-il, près d'entrer dans la tombe, Et ta queue ne te protégera pas. Plus tu t'es élevé, Plus l'orage te frappe. Tu cherchais les hauteurs proches de la foudre : Voilà ce qui t'arrive ; moi qui cherche des terriers, Je ris, en attendant que tu sois réduit en poussière. » Tandis que le Renard se moquait ainsi, Il attrapait de nombreux poulets En les gobant ; Mais lorsque le Ciel pardonne à l'Écureuil : Il ne brille plus, ni ne tonne ; L'orage cesse ; et le beau temps revient. Un chasseur ayant remarqué Les allées et venues du Renard autour de sa tanière : « Tu paieras, dit-il, mes poulets. » Aussitôt, une meute de chiens Fait fuir le compère. L'Écureuil le voit s'enfuir Devant la meute qui le poursuit. Ce plaisir ne dure pas longtemps, Car bientôt il le voit aux portes de la mort. Il le voit ; mais il ne s'en réjouit pas, Ayant appris de sa propre misère.
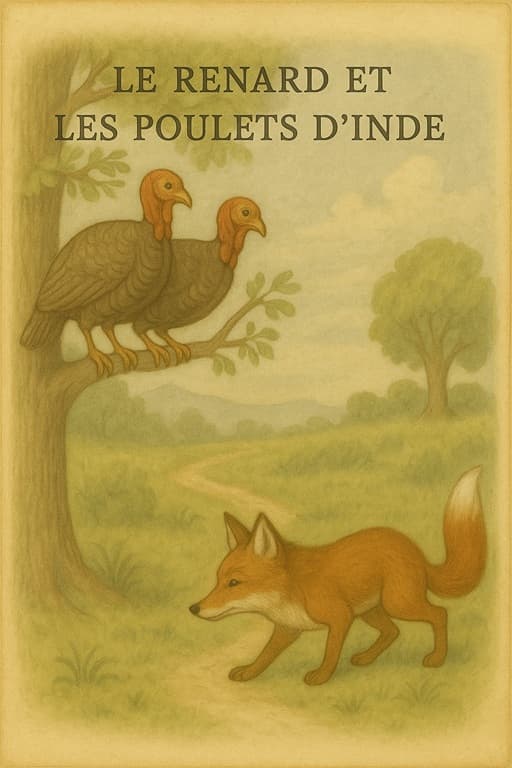
Présentation :
« Le Renard et les Poulets d’Inde » est la dix-huitième fable du Livre XII de Jean de La Fontaine, publiée en 1694. Elle met en scène un renard rusé tentant de tromper des dindons perchés sur un arbre. La fable illustre la méfiance face aux flatteries et aux ruses des prédateurs. Morale : la prudence et la vigilance sont les meilleures armes contre la tromperie.
– Jean de La Fontaine (1694)
Pour attaquer des dindons perchés sur un arbre, Le Renard rusé tourne autour, cherchant une faille. Voyant chaque dindon vigilant, Il s’exclame : "Quoi ! Ils se moquent de moi ? Eux seuls échapperont à la loi commune ? Non, par tous les dieux, non." Il met alors en œuvre ses ruses habituelles. Feignant de partir, il revient sur ses pas, Fait le mort, salue les dindons en passant, Et pousse un long soupir en disant : "Je meurs ; Dieux, pardonnez-moi mes erreurs." Après plusieurs tours, tantôt feignant la colère, Tantôt l’humilité, il finit par se pendre Contre l’arbre, simulant la mort. Les dindons, croyant à sa mort, Descendent de leur arbre pour célébrer sa perte. Mais le Renard se réveille au bruit, Et les attrape un à un. Ayant tous les dindons croqués, Il déclare : "Cette fois, j’ai bien utilisé ma ruse. Apprenez que tout flatteur Vit aux dépens de celui qui l’écoute."